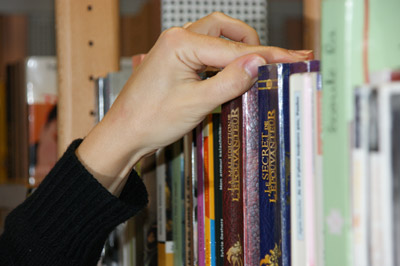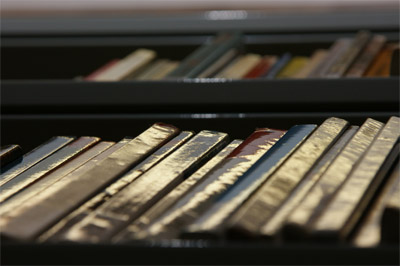|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(1)
| Localisation | Propriétaire | Code statistique | Cote | Statut | Support | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RESERVE ETAGE - Périodiques | --- | --- | 7014321 | EN RESERVE | PERIODIQUE | Disponible |
Dépouillements

 Ajouter le résultat dans votre panier
Ajouter le résultat dans votre panierSphères de reconnaissance / Olivier Abel in Revue d'éthique et de théologie morale, n°281 "Hors série 11" ([01/10/2014])
Titre : Sphères de reconnaissance Type de document : LIVRE Auteurs : Olivier Abel, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 9-21 Accompagnement : 2014 Langues : Français (fre) Résumé : L’idée de reconnaissance désamorce ce qu’une posture de dénonciation pourrait avoir de purement extérieur, pour penser les liens de l’intérieur. Et si la dénonciation est portée par l’idéal d’émancipation, la reconnaissance sait l’importance des attachements. Mais la reconnaissance ne saurait retomber dans une forme de quiétude trop apaisée, trop crédule aux médiations et réconciliations. Il doit rester une sorte d’inquiétude critique, elle-même mise en émoi par toutes les formes du déni de reconnaissance : le sentiment de méconnaissance à cet égard restera un sûr guide du travail de reconnaissance. Nous sommes notamment très focalisés sur l’injustice comprise comme inégalité économique, et sur la violence et la domination dans des rapports de force. Mais nous n’accordons peut-être pas assez d’importance à l’humiliation d’être sans parole ni estime de soi. La pluralité des registres de la vie sociale, avoir, pouvoir, valoir, exposée très tôt dans l’œuvre de Ricœur, nous aidera ainsi à élargir l’amplitude de la reconnaissance, jusqu’à lui restituer son sens épique. Permalink : https://nantes.bibliossimo.info/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=136478
in Revue d'éthique et de théologie morale > n°281 "Hors série 11" [01/10/2014] . - p. 9-21[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Localisation Propriétaire Code statistique Cote Statut Support Disponibilité RESERVE ETAGE - Périodiques --- --- 7014321 EN RESERVE PERIODIQUE Disponible Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Temporalité de la reconnaissance / Guilhem Causse in Revue d'éthique et de théologie morale, n°281 "Hors série 11" ([01/10/2014])
Titre : Temporalité de la reconnaissance Type de document : LIVRE Auteurs : Guilhem Causse, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 23-35 Accompagnement : 2014 Langues : Français (fre) Résumé : Tenter de définir ce qu’est la reconnaissance pour Paul Ricœur est de l’ordre de la gageure. En effet, comme Jean Greisch l’écrit dans la préface au premier volume de la Philosophie de la volonté, cette œuvre « peut être lue, du début à la fin, comme un vaste “parcours de la reconnaissance” ». Une première manière d’aborder la question vient au début de son œuvre, dans « L’image de Dieu et l’épopée humaine » et revient comme en écho dans le Parcours de la reconnaissance. Elle consiste en l’analyse des sphères de reconnaissance, dans l’attention à leur distinction. Une autre manière est exposée dans Temps et récit, examinant la temporalité de l’expérience. C’est cette exposition que nous suivrons. Le point de vue temporel a l’intérêt d’être transversal par rapport à l’abord structurel, et si celui-ci décline la diversité des sphères, celui-là soulignera l’unité de l’expérience. Cette unité se déploie selon trois temps qui vont former ensemble la temporalité de la reconnaissance : le temps de la vision où le passé est rassemblé sous la métaphore de l’éternité, celui de la visitation où le présent se fait voix, échange de paroles, et celui du suspens où l’avenir se propose comme monde possible d’une action commune et durable. Ce troisième temps nous permettra de revenir à la triple sphère du valoir, du pouvoir et de l’avoir, afin de montrer comment ces sphères tour à tour sont traversées. En retour se posera la question d’un temps et d’un lieu privilégiés de reconnaissance, à l’entrecroisement de l’expérience personnelle et commune, point source d’où elle jaillit chaque fois à nouveau. Permalink : https://nantes.bibliossimo.info/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=136479
in Revue d'éthique et de théologie morale > n°281 "Hors série 11" [01/10/2014] . - p. 23-35[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Localisation Propriétaire Code statistique Cote Statut Support Disponibilité RESERVE ETAGE - Périodiques --- --- 7014321 EN RESERVE PERIODIQUE Disponible Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
De la poétique de l'amour à la dialectique homme-femme / Alain Thomasset in Revue d'éthique et de théologie morale, n°281 "Hors série 11" ([01/10/2014])
Titre : De la poétique de l'amour à la dialectique homme-femme : Paul Ricoeur et Gaston fessard sur la question de la reconnaissance structurelle Type de document : LIVRE Auteurs : Alain Thomasset (1957-....), Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 37-52 Accompagnement : 2014 Langues : Français (fre) Résumé : Le Parcours de la reconnaissance se termine par l’évocation d’une « bienveillance » qui puisse être au plan originaire du lien social « la contrepartie pacifique de la lutte pour la reconnaissance ». Mais l’explicitation de cette tension entre lutte et bienveillance reste pour Ricœur un programme à accomplir. Or l’anthropologie sociale de G. Fessard se situe à la hauteur des questions posées par Ricœur. Pour Fessard, c’est l’interférence constante des deux dialectiques sociales maître-esclave et homme-femme qui rend compte de la genèse du lien social et de la réalité historique. La lutte à mort, à la base de tous les rapports sociaux et fondatrice d’un rapport de domination, est en fait toujours travaillée de l’intérieur par la dialectique de la reconnaissance réciproque d’amour dont le rapport homme-femme est la figure. Là où Ricœur fait jouer à l’amour un rôle essentiellement poétique et méta-éthique de surabondance non institutionnel, Fessard s’aventure à penser une dialectique entre justice et charité qui est structurante de la création du lien social à tous les niveaux. La dialectique homme-femme est une manière de traduire en termes d’anthropologie sociale fondamentale le fonds de bienveillance de l’homme auquel Ricœur fait appel pour faire face au défi de Hobbes. Elle donne une origine dialectique à « l’amitié politique » et autorise à penser l’amplitude de la reconnaissance à divers échelons de la vie sociale et politique. Permalink : https://nantes.bibliossimo.info/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=136480
in Revue d'éthique et de théologie morale > n°281 "Hors série 11" [01/10/2014] . - p. 37-52[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Localisation Propriétaire Code statistique Cote Statut Support Disponibilité RESERVE ETAGE - Périodiques --- --- 7014321 EN RESERVE PERIODIQUE Disponible Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Don cérémoniel, paradoxe de l'altérité et reconnaissance réciproque / Marcel Hénaff in Revue d'éthique et de théologie morale, n°281 "Hors série 11" ([01/10/2014])
Titre : Don cérémoniel, paradoxe de l'altérité et reconnaissance réciproque Type de document : LIVRE Auteurs : Marcel Hénaff, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 53-71 Accompagnement : 2014 Langues : Français (fre) Résumé : L’exigence de reconnaissance réciproque éclaire la nature même du don cérémoniel en tant que ce type de don est d’abord une procédure d’alliance entre deux partenaires ou deux groupes susceptibles de s’opposer. En cela le don cérémoniel se différencie profondément des deux autres principaux types de don : le don gracieux unilatéral et le don solidaire mutuel. Le don cérémoniel est au cœur de la vie sociale des sociétés traditionnelles, car il est au cœur de l’alliance exogamique. Il vise à surmonter l’altérité radicale de deux groupes, mais doit en même temps affirmer cette altérité (le même ne saurait s’unir au même comme le postule la prohibition de l’inceste). Il faut que l’autre soit en quelque sorte radicalement autre pour que l’alliance soit possible i. e. légitime. Du point de vue logique, cette relation de réciprocité est à la fois une relation interne d’implication et une relation non prédictible de contingence ; donc à la fois analytique selon un point de vue et synthétique selon un autre. C’est ce que suppose le geste de reconnaissance à la fois exigible et libre. La réponse à construire pour assumer et surmonter ce paradoxe passera par les approches de Mauss, Lévi-Strauss, Peirce, Wittgenstein. Permalink : https://nantes.bibliossimo.info/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=136481
in Revue d'éthique et de théologie morale > n°281 "Hors série 11" [01/10/2014] . - p. 53-71[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Localisation Propriétaire Code statistique Cote Statut Support Disponibilité RESERVE ETAGE - Périodiques --- --- 7014321 EN RESERVE PERIODIQUE Disponible Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
La dimension cérémonielle de la reconnaissance dans la justice / Antoine Garapon in Revue d'éthique et de théologie morale, n°281 "Hors série 11" ([01/10/2014])
Titre : La dimension cérémonielle de la reconnaissance dans la justice Type de document : LIVRE Auteurs : Antoine Garapon (1952-....), Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 73-87 Accompagnement : 2014 Langues : Français (fre) Résumé : La justice est devenue en quelques années le lieu institutionnel de la reconnaissance, le juge occupant la place du « tiers de reconnaissance ». Comment alors cette fonction anthropologiquement essentielle va-t-elle pouvoir se loger dans des formes juridiques destinées à un autre emploi ? Pour répondre à cette question, il faudra l’examiner à partir des différentes formes de justice. La justice ordinaire, bien sûr, qui a été particulièrement investie ces dernières années, notamment par les victimes qui se sont emparées des prétoires comme d’un espace pour publier leurs souffrances et se plaindre du déni de reconnaissance dont elles pâtissaient de la part des pouvoirs publics. Mais aussi la justice constitutionnelle de laquelle est également attendue une fonction de reconnaissance : la demande de certaines minorités – songeons aux homosexuels – n’est plus la liberté de vivre comme elles l’entendent mais de se voir reconnaître dans leur différence. C’est vrai aux États-Unis comme en France avec l’apparition de la question prioritaire de constitutionnalité. La reconnaissance est enfin l’un des buts affichés de la justice dite « transitionnelle », qui est convoquée après des crimes de masse pour hâter la réconciliation. Toutes ces formes seront recensées pour analyser comment s’y loge la reconnaissance. Permalink : https://nantes.bibliossimo.info/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=136482
in Revue d'éthique et de théologie morale > n°281 "Hors série 11" [01/10/2014] . - p. 73-87[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Localisation Propriétaire Code statistique Cote Statut Support Disponibilité RESERVE ETAGE - Périodiques --- --- 7014321 EN RESERVE PERIODIQUE Disponible Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Le culte, la collecte, l'apostolat / Corina Combet-Galland in Revue d'éthique et de théologie morale, n°281 "Hors série 11" ([01/10/2014])
Titre : Le culte, la collecte, l'apostolat : des liturgies de reconnaissance chez l'apôtre Paul Type de document : LIVRE Auteurs : Corina Combet-Galland, Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 89-105 Accompagnement : 2014 Langues : Français (fre) Résumé : L’écriture évangélique est travail de reconnaissance ; elle tisse la mort du prophète Jésus sur la trame des Écritures bibliques, transfigure ainsi la fin en commencement. Dans les premiers textes où s’élabore la foi en Christ, les lettres de l’apôtre Paul, trois gestes, à dimension liturgique, portent la dynamique structurante de la reconnaissance. La vie croyante elle-même est d’abord comprise comme un culte, une offrande vivante de soi à Dieu ; mais si la foi de chacun n’est qu’une part, reçue en partage, le culte implique la complémentarité des membres, il exige une juste estime de chacun pour chacun. La collecte ensuite, entreprise par Paul dans les cités du bassin méditerranéen en faveur de la communauté de Jérusalem, œuvre au lien et se teinte d’expressions liturgiques : elle se met au service de la communion, est largesse qui se fait louange, eucharistie rendue au Dieu de toute grâce. Enfin l’apostolat : il n’a pour lisibilité que le don de soi, marqué de l’amour poignant du Crucifié, et pour authentification, la communauté elle-même, ainsi sollicitée, en sa vivacité. Permalink : https://nantes.bibliossimo.info/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=136483
in Revue d'éthique et de théologie morale > n°281 "Hors série 11" [01/10/2014] . - p. 89-105[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Localisation Propriétaire Code statistique Cote Statut Support Disponibilité RESERVE ETAGE - Périodiques --- --- 7014321 EN RESERVE PERIODIQUE Disponible Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Le culte protestant / Raphaël Picon in Revue d'éthique et de théologie morale, n°281 "Hors série 11" ([01/10/2014])
Titre : Le culte protestant : une école de la reconnaissance Type de document : LIVRE Auteurs : Raphaël Picon (1968-....), Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 107-114 Accompagnement : 2014 Langues : Français (fre) Résumé : La reconnaissance est le grand sujet du culte protestant. De sa première action : l’accueil et la formation de la communauté à travers la proclamation d’une grâce inconditionnelle, à son dernier geste : l’envoi au monde d’une communauté réaffirmée dans toutes ses capacités d’action et de pensée, le culte se déroule comme un récit spécifique. À travers ce processus, le participant se découvre transformé de manière créatrice par la reconnaissance de Dieu dont il est l’objet, au point d’être rendu capable d’une gratitude radicale et totalement désintéressée. Permalink : https://nantes.bibliossimo.info/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=136484
in Revue d'éthique et de théologie morale > n°281 "Hors série 11" [01/10/2014] . - p. 107-114[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Localisation Propriétaire Code statistique Cote Statut Support Disponibilité RESERVE ETAGE - Périodiques --- --- 7014321 EN RESERVE PERIODIQUE Disponible Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Liturgie et reconnaissance / Philippe Bordeyne in Revue d'éthique et de théologie morale, n°281 "Hors série 11" ([01/10/2014])
Titre : Liturgie et reconnaissance : enjeux actuels pour l'éthique théologique Type de document : LIVRE Auteurs : Philippe Bordeyne (1959-....), Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 115-130 Accompagnement : 2014 Langues : Français (fre) Résumé : Tandis qu’on observe un renouveau dans la prise en compte de la liturgie, et donc du corps et de la ritualité, en théologie, l’article en montre la pertinence pour la théologie morale. L’approche philosophique de la reconnaissance aide à comprendre en quoi les pratiques liturgiques rendent plus apte à vivre l’éthique. Les théologiens communautariens anglo-saxons voient dans le culte chrétien une instance de résistance à la culture individualiste qui imprime dans les sujets, presque malgré eux, un nouveau sens de l’autre. Avec Ricœur, il convient d’insister davantage sur la médiation de la réflexion dans le moment cérémoniel de la reconnaissance mutuelle. Les gestes liturgiques sont d’autant plus féconds pour l’éthique qu’ils s’accompagnent d’une catéchèse qui en déploie la force symbolique et donnent à penser de manière nouvelle le sens de la vie humaine. L’expérience religieuse qu’offre le site cérémoniel chrétien assume le renversement propre au processus de reconnaissance quand il passe de l’actif (je reconnais) au passif (je demande à être reconnu). Elle a néanmoins vocation à le dépasser grâce à la reconnaissance d’un lien social plus originaire qui fonde la réconciliation (nous sommes déjà reconnus comme fils et frères). Permalink : https://nantes.bibliossimo.info/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=136485
in Revue d'éthique et de théologie morale > n°281 "Hors série 11" [01/10/2014] . - p. 115-130[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Localisation Propriétaire Code statistique Cote Statut Support Disponibilité RESERVE ETAGE - Périodiques --- --- 7014321 EN RESERVE PERIODIQUE Disponible Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Parcours de la reconnaissance dans l'entreprise / Cécile Renouard in Revue d'éthique et de théologie morale, n°281 "Hors série 11" ([01/10/2014])
Titre : Parcours de la reconnaissance dans l'entreprise Type de document : LIVRE Auteurs : Cécile Renouard (1968-....), Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 131-147 Accompagnement : 2014 Langues : Français (fre) Résumé : Comment la sphère économique et en particulier l’institution entreprise peuvent-elles favoriser la reconnaissance de la valeur morale et sociale de chaque personne ? Trois dimensions centrales de la reconnaissance sont appliquées à l’analyse du fonctionnement des entreprises. La première dimension, celle du déploiement de l’identité relationnelle des personnes, peut être visée comme l’horizon et la finalité ultime de l’entreprise (et de toute institution). La deuxième dimension, celle du respect et de l’estime de soi, définit les conditions de la réalisation de ces capacités relationnelles. Il s’agit, d’une part, de définir des frontières, pour éviter que la sphère marchande n’envahisse les autres et, d’autre part, de repenser les critères de grandeur/domination à l’œuvre dans la sphère de l’entreprise et de mettre en évidence les inégalités illégitimes, en fixant des bornes. Il est aussi nécessaire de faire valoir les ressources éthiques et spirituelles à notre disposition, pour lutter contre les pathologies sociales engendrées par le modèle économique libertarien, financiarisé et court-termiste. Ces ressources spirituelles apparaissent bien dans la troisième dimension de la reconnaissance, celle de la gratitude : cette dimension fonde les autres, elle est celle sur laquelle, implicitement, tout contrat s’appuie, mais elle est également appelée à trouver un espace explicite au sein des entreprises. Permalink : https://nantes.bibliossimo.info/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=136486
in Revue d'éthique et de théologie morale > n°281 "Hors série 11" [01/10/2014] . - p. 131-147[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Localisation Propriétaire Code statistique Cote Statut Support Disponibilité RESERVE ETAGE - Périodiques --- --- 7014321 EN RESERVE PERIODIQUE Disponible Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Les Institutions hospitalières / Jean-Philippe Pierron in Revue d'éthique et de théologie morale, n°281 "Hors série 11" ([01/10/2014])
Titre : Les Institutions hospitalières : des institutions de la reconnaissance ? Type de document : LIVRE Auteurs : Jean-Philippe Pierron (1964-....), Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 149-164 Accompagnement : 2014 Langues : Français (fre) Résumé : Comme leur nom l’indique, les institutions hospitalières tentent d’être la traduction et la transcription sociale d’une éthique de l’hospitalité. À la sollicitude eu égard à l’homme vulnérabilisé par la maladie, le handicap ou le vieillir, vécue dans la relation interpersonnelle, elles tentent d’apporter le prolongement et la réplique d’un ensemble de médiations institutionnelles tout à la fois théoriques (une épistémologie et une sémiologie de la maladie) et pratiques (une sémantique de l’action interprétant la biographie de l’homme malade). Or c’est à cet endroit que les enjeux théoriques et pratiques de la reconnaissance s’inscrivent et se déploient, car l’institution hospitalière vit d’un tiraillement constitutif. Elle place épistémologiquement la reconnaissance sous le régime conceptuel de l’identification (vérité de science). Mais elle vise éthiquement et politiquement une reconnaissance mutuelle de la maladie comme épreuve existentielle (vérité d’existence), sous peine de fabriquer de la non-reconnaissance, qu’elle soit humiliation, irrespect ou mépris. À quelles conditions l’institution hospitalière peut-elle être une institution de la reconnaissance si d’une part elle est dominée par la survalorisation du connaître sur le reconnaître ; et si d’autre part la bureaucratisation croissante du monde hospitalier dévalue les pratiques de coopérations et de reconnaissance au profit du souci gestionnaire de coordination ? Permalink : https://nantes.bibliossimo.info/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=136487
in Revue d'éthique et de théologie morale > n°281 "Hors série 11" [01/10/2014] . - p. 149-164[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Localisation Propriétaire Code statistique Cote Statut Support Disponibilité RESERVE ETAGE - Périodiques --- --- 7014321 EN RESERVE PERIODIQUE Disponible Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Dette, gratitutde et libération / Denis Müller in Revue d'éthique et de théologie morale, n°281 "Hors série 11" ([01/10/2014])
Titre : Dette, gratitutde et libération : Regard théologique et éthique sur l'asymétrie entre la lutte pour la reconnaissance et l'événement d'être reconnu Type de document : LIVRE Auteurs : Denis Müller (1947-....), Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 165-181 Accompagnement : 2014 Langues : Français (fre) Résumé : L’auteur reconstruit le débat sur la reconnaissance à partir des travaux de Honneth, Ricœur et Hénaff. Après avoir souligné l’actualité sociale de cette thématique, il s’interroge sur sa genèse, puis s’efforce de saisir la dimension de transcendance sans laquelle la reconnaissance risquerait de tourner sur elle-même. Remontant, avec Fischbach, à Hegel et à Fichte, il convient de se demander aussi comment la thématique de la réciprocité ne court-circuite pas celle de la différence. La notion d’injustice est en effet trop souvent tirée du côté d’une stricte égalité, sans tenir compte des situations différenciées des personnes concernées. La discussion sur le partenariat entre personnes de même sexe (PACS), puis, plus radicalement, sur le « mariage pour tous », fournit un bon exemple de la double dimension, sociale et religieuse, de la reconnaissance. Les ambiguïtés du langage de la reconnaissance ne sauraient conduire ni à un simple égalitarisme, ni à un différentialisme qui se détournerait de la visée fondamentale d’équité sans laquelle il n’y aurait plus d’éthique sociale. La dimension proprement religieuse de la reconnaissance vient alors rappeler la nécessaire a-symétrie qui fait de la reconnaissance un événement de décentrement, par-delà toute mise à plat. Permalink : https://nantes.bibliossimo.info/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=136488
in Revue d'éthique et de théologie morale > n°281 "Hors série 11" [01/10/2014] . - p. 165-181[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Localisation Propriétaire Code statistique Cote Statut Support Disponibilité RESERVE ETAGE - Périodiques --- --- 7014321 EN RESERVE PERIODIQUE Disponible Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
La grand pauvreté, pierre de touche pour la question de la reconnaissance / Etienne Grieu in Revue d'éthique et de théologie morale, n°281 "Hors série 11" ([01/10/2014])
Titre : La grand pauvreté, pierre de touche pour la question de la reconnaissance Type de document : LIVRE Auteurs : Etienne Grieu (1962-....), Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 183-199 Accompagnement : 2014 Langues : Français (fre) Résumé : Le présupposé qui guide l’auteur est que la rencontre des personnes marquées par la grande pauvreté joue comme un révélateur pour penser la reconnaissance. À leur contact en effet, on est conduit à distinguer deux aspects dans le travail de reconnaissance : une lutte dans laquelle les protagonistes font l’épreuve de leur identité en confrontant leurs capacités, d’une part, et, d’autre part, un appel à l’existence, qui n’a pas d’autre « parce que » en dehors d’un « parce que c’est toi ». L’auteur souligne l’importance cruciale de ce deuxième aspect lorsqu’un chemin s’engage avec des personnes en grande précarité. À partir de là, on peut revisiter l’ensemble des rapports sociaux comme une combinaison de rapports de forces et d’appels grâce auxquels nous nous redisons mutuellement que « nous ne sommes pas des choses », selon la formule de Claude Lefort. Cette distinction permet d’interroger en retour les formes instituées du vivre-ensemble en posant la question de la place faite à ce deuxième versant de la reconnaissance ainsi qu’aux moyens de lui donner force et consistance. Permalink : https://nantes.bibliossimo.info/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=136489
in Revue d'éthique et de théologie morale > n°281 "Hors série 11" [01/10/2014] . - p. 183-199[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Localisation Propriétaire Code statistique Cote Statut Support Disponibilité RESERVE ETAGE - Périodiques --- --- 7014321 EN RESERVE PERIODIQUE Disponible Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Ouverture à propos de la reconnaissance institutionnelle dans la société contemporaine / Jean-Daniel Causse in Revue d'éthique et de théologie morale, n°281 "Hors série 11" ([01/10/2014])
Titre : Ouverture à propos de la reconnaissance institutionnelle dans la société contemporaine Type de document : LIVRE Auteurs : Jean-Daniel Causse (1962-....), Auteur Année de publication : 2014 Article en page(s) : p. 201-207 Accompagnement : 2014 Langues : Français (fre) Résumé : En conclusion du dossier, Jean-Daniel Causse reprend la question de la reconnaissance du point de vue des enjeux institutionnels contemporains. Avec une critique du concept de reconnaissance, trois aspects sont développés : d’abord, il faut se demander si une réponse à la demande de reconnaissance doit toujours être adéquate, ou symétrique, ou si elle n’a pas à assumer une part de dissymétrie ou d’écart qui n’en reste pas moins une façon de répondre à la quête de reconnaissance. Ensuite, on peut s’interroger sur la question de savoir si l’acte de reconnaissance ne comporte pas toujours le risque d’enfermer l’autre dans ce dans quoi on le reconnaît. Comment penser alors des modalités sociales et politiques de la reconnaissance qui préservent la capacité pour chacun de ne pas être seulement confondu avec des formes de soi et qui soutiennent une indétermination subjective ? Enfin, on peut faire retour à cette forme de reconnaissance communautaire mise en place dans le christianisme où les différences culturelles, sociales, mais aussi les particularités de chacun, sont reconnues en fonction de ce qui n’est la propriété de personne et dont le Christ du tombeau vide est la figure. La reconnaissance mutuelle se construit grâce à ce qui n’étant à personne est offert à chacun. Permalink : https://nantes.bibliossimo.info/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=136490
in Revue d'éthique et de théologie morale > n°281 "Hors série 11" [01/10/2014] . - p. 201-207[article]Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Localisation Propriétaire Code statistique Cote Statut Support Disponibilité RESERVE ETAGE - Périodiques --- --- 7014321 EN RESERVE PERIODIQUE Disponible Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !